Chroniques d’experts
Comment bien innover grâce au crowdsourcing

Avec l’avènement des nouvelles technologies collaboratives issues du Web 2.0, les organisations publiques et privées sont de plus en plus amenées à identifier et à explorer des idées innovantes au-delà de leurs traditionnelles frontières organisationnelles, en impliquant clients, partenaires, concurrents ou communautés en ligne dans leurs processus d’innovation.
Ce phénomène de collaboration « ouverte » est aujourd’hui connu dans la littérature managériale sous différentes appellations, telles que « la collaboration de masse » (Tapscott et Williams 2006), « la collaboration ouverte » (Coleman et Levine 2008), « l’innovation ouverte », « l’intelligence collective » (Surowiecki 2004) ou encore « le crowdsourcing » (Howe, J. (2006), The Rise of Crowdsourcing, Wired, 14(6), June).
Le « crowdsourcing » serait le terme le plus exact parmi ces appellations pour désigner ce phénomène. Signifiant littéralement « externalisation vers la foule », il peut être défini comme un modèle de collaboration basé sur les technologies du Web social pour résoudre les problèmes d’organisation, en partenariat avec les communautés en ligne (Oh et al. 2012).
Les approches de crowdsourcing sont censées avoir des avantages pour :
1. accéder à la diversité des idées pour la résolution de problèmes de manière novatrice ;
2. collecter des idées pertinentes au plus près des besoins réels des clients ou des citoyens ;
3. réaliser des performances supérieures à celles des petites équipes d’experts de l’organisation en termes de qualité.
S’ajoute à cela l’indéniable avantage de réduire les coûts et les délais de R&D, parfois de façon drastique.
Le crowdsourcing se généralise dans le privé comme dans le public
Collecter des avis ou des informations auprès de la « foule » pour innover, créer un logo ou un slogan publicitaire, concevoir une application mobile ou un produit marketing, tester un service client ou encore résoudre un problème en biologie… Les applications ne cessent de se diversifier et les plateformes web dédiées à cet exercice fleurissent à travers le monde. On en compte actuellement plus de 1800 : freelancer.com, innocentive.com, 99designs.com,threadless.com, etc. (source : www.crowdsourcing.org).
Dans le secteur privé, voici des exemples concrets d’initiatives de crowdsourcing :
> le concours de design pour la conception de la bouteille de Heineken ;
> le développement et l’évaluation des produits, à l’instar du KLM Bluelab ;
> la distribution à grande échelle des tâches : le Mechanical Turk d’Amazon ;
> l’animation des discussions ouvertes pour résoudre des problèmes complexes, utilisée par exemple par Unilever.
>>> Lire à ce sujet l’article paru dans Harvard Business Review : Les avantages de l’innovation clandestine.
Dans le secteur public, les initiatives de crowdsourcing se concentrent généralement sur la mobilisation en ligne des citoyens comme nouvelle ressource pour l’innovation et la résolution de problèmes pour les organismes gouvernementaux (exemples : challenge.gov,policypitch.com). L’exemple du district de Columbia aux Etats-Unis est tout à fait significatif. Depuis 2009, les développeurs indépendants, les entreprises et les centres de recherches publics ou privés peuvent rivaliser dans un concours annuel nommé Apps For Democracy (cité dans Baumgarten et Chui, 2009, « E-government 2.0″, McKinsey Quarterly, 4, disponible en ligne). L’objectif est de créer des services innovants (applications pour iPhone, applications Web composites ou Mashups) destinés à résoudre des problèmes concrets que les administrés ont au préalable exprimés à travers les réseaux sociaux. Les agences du district de Columbia mettent à la disposition des participants les données nécessaires (rapports, statistiques démographiques, données sur les usages, composants réutilisables…) pour élaborer ces nouveaux services.
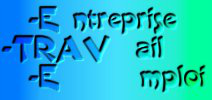 E-ENCYCLOPEDIE- -ETRAVE-
E-ENCYCLOPEDIE- -ETRAVE- 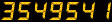 Visiteurs depuis fin 2012
Visiteurs depuis fin 2012




