À l’occasion des assises de l’industrie, L’Usine Nouvelle brosse le portrait des nouvelles chaînes de valeur industrielles et de la compétition autour du manufacturing. Une bataille à 10 000 milliards de dollars dans laquelle la France peine à trouver sa place.
Sur les hauts plateaux sud-africains dans la banlieue de Pretoria, à Rosslyn, entrer dans l’usine Nissancernée de palmiers peut révéler des surprises comme celle de découvrir un rack de composants fabriqués à 8 400 km de là, en Franche-Comté. L’explication ? Renault fait assembler en kit (CKD) des milliers de Sandero chez Nissan à Rosslyn. Et pour composer ce Lego, le constructeur s’appuie sur son Industrial logistic network (ILN). Ce réseau optimise son sourcing au plan mondial, déterminant le fournisseur le mieux placé en termes de prix, de droits de douane ou de logistique. Cet exemple illustre la grammaire actuelle de l’industrie : globalisation du sourcing, désintégration des chaînes de valeur, maximisation des avantages comparés… Une nouvelle carte mondiale du manufacturing sur laquelle se joue une bataille, celle du partage des 10 000 milliards de dollars de valeur ajoutée industrielle. "Celle-ci se divise à peu près en deux, explique Max Blanchet, associé senior chez Roland Berger : une moitié aux pays à coûts élevés, l’autre aux pays low cost. Mais cette ligne évolue sans cesse. Selon la valeur de ses produits, chaque industriel doit ajuster son modèle productif et ses choix d’investissement."
Retrouvez notre grand dossier "Les nouvelles usines du Monde"
Pour les nations lancées dans une compétition globale, jamais les termes "attractivité" ou "compétitivité" n’ont eu autant de sens. "La durée du “payback” attendu pour un investissement s’est raccourcie. Le plus souvent trois à cinq ans. Les ressources sont rares, les choix longuement réfléchis. Il n’y a plus le droit à l’erreur. Cela suscite une compétition intense entre les localisations", lance Stéphane Baller, associé responsable Crossborder et Pays émergents chez EY. Comment un pays peut-il être attractif, capter les investissements et les emplois, et développer sa base productive ? C’est là le cœur du furieux débat sur la désindustrialisation en France.
Et les faits ? "Hormis le sujet principal qui est l’accès à de nouveaux marchés, les deux déterminants clés restent le coût de la main-d’œuvre et celui de l’énergie", juge Pierre Derieux, le directeur associé senior et responsable du centre d’expertise industrie du BCG à Paris, mais l’équation est complexe. Lors d’un choix d’investissement, nos clients passent en revue une batterie de critères." Lesquels ? Disponibilité et compétences de la main-d’œuvre, droit social, supply chain, coûts du foncier, infrastructures, sans oublier la fiscalité globale et les subventions ou autres zones franches, dont les pays émergents se sont fait une spécialité… "Lors d’une implantation, les industriels veulent aussi avoir des scénarios de sortie crédibles face aux risques naturels, économiques et sociaux", explique Stéphane Baller. Ajoutons l’enchevêtrement croissant des accords de libre-échange. Si Alstomassemble des locomotives dans un lieu aussi improbable qu’Astana au Kazakhstan, c’est après une énorme commande mais aussi car cela lui ouvre les portes de l’Union douanière avec la Russie et la Biélorussie. Max Blanchet résume l’attractivité en cinq points : le degré de spécialisation, l’innovation technologique, la flexibilité du travail, le cadre des affaires, et l’excellence industrielle. Selon lui, "la France est fortement décalée sur tous ces critères".
UNE FRANCE FORTEMENT DÉCALÉE
Dans ce grand benchmark, des nations émergent comme la Thaïlande, la Colombie ou le Maroc ; certaines confortent leur place tel le Mexique ; ou renaissent comme les États-Unis. D’autres doivent revoir leur modèle, comme la Chine. La France, elle, semble vouée au déclin. Parmi les grandes économies, c’est celle où la part de l’industrie est la plus faible dans le PIB, à 13 %. Au pays des 71 pôles de compétitivité, des 34 plans d’excellence ou des 15 comités de filières d’Arnaud Montebourg, la bataille du manufacturing est-elle perdue ? La France n’a-t-elle le choix que d’une nébuleuse "économie de l’innovation" ? Pas sûr.
"Ce qui frappe, c’est la vitesse avec laquelle les positions respectives des nations évoluent : il n’y a plus de situation acquise. Le retour en force des États-Unis l’illustre bien : des millions d’emplois y sont créés grâce au renforcement de la compétitivité du pays, avec notamment le gaz de schiste et les renégociations des salaires et du cadre social dans l’automobile", affirme Pierre Derieux. Autre exemple : la hausse des coûts en Chine. Car elle a cessé d’être le mètre étalon du low cost. Non que la Chine ne soit plus une puissance industrielle. Au contraire. Depuis 2007, sa valeur ajoutée manufacturière a doublé quand celle de l’Europe reculait de 10 % ! Elle est désormais la première, devant les États-Unis, et pèse plus de 20 % de l’industrie mondiale. Mais le temps où le "China price" terrorisait tous les sous-traitants est révolu. "Le rythme d’évolution des coûts depuis dix ans nous a surpris. Cela change l’équation globale dans l’industrie manufacturière", affirme Stéphane Baller. À Shanghai, le salaire minimum (le plus élevé du pays) s’élève à 194 euros par mois. Il est de 135 euros en Tunisie, 49 euros en Inde ou 159 euros en Bulgarie. Le smic bulgare inférieur à celui de Shanghai ! Vertige…
Même Terry Gou, l’impérieux patron du géant taïwanais Foxconn, se lamente et songe à automatiser ses usines chinoises où s’active plus d’un million de salariés. La Chine par son entrée dans l’OMC en 2001 avait redéfini la globalisation en offrant une quantité illimitée de travail à prix cassé. Elle semble toucher son "tournant de Lewis", l’étape où cet afflux cesse et les salaires s’envolent selon la théorie d’Arthur Lewis, le prix Nobel d’économie en 1979. Les industries légères comme la confection ont été les premières à prendre le pli. Les donneurs d’ordres misent sur le Vietnam, l’Éthiopie ou le Bangladesh, pays où le drame du Rana Plaza a rappelé que l’industrie ne saurait être une jungle. Cette nouvelle donne chinoise rouvre le jeu. "Le cas du Mexique est fascinant, remarque Pierre Derieux. Au rythme actuel, si l’on prend en compte les écarts de productivité, les coûts unitaires y seront en 2015 30 % inférieurs à ceux de la Chine où les salaires augmentent rapidement. Le Mexique bénéfice de nombreux facteurs favorables, comme la zone de prix du gaz de schiste américain. Et ses produits exportés sont trois à cinq fois plus denses en valeur ajoutée que ceux de la Chine."
L’INTERNATIONALISATION COMME REMÈDE
Dans l’Asie du Sud-Est bouillonnante, d’autres nations veulent leur part de ces changements. La Thaïlande notamment s’invente en hub industriel. Sa recette : une fiscalité attractive, un cadre des affaires bien noté et une politique publique volontariste en dépit des coups d’État et d’inondations récurrents. Selon un modèle éprouvé en Asie, ce pays de plein-emploi s’est doté d’immenses zones industrielles gérées par des développeurs tels Amata ou Hemaraj, attirant les investisseurs étrangers, nippons surtout, qui ont fait de ce pays un véritable porte-avions japonais.
Dans l’automobile, Toyota, Nissan, Mazda ou Isuzu jouent ce jeu à fond. À 80 km de Bangkok, Nakorn, le plus grand "estate" d’Amata, s’étend ainsi sur 30 km2. Dans plus de 500 usines, un demi-million de salariés s’y activent. Ce modèle n’aura sans doute qu’un temps, car la Thaïlande, à la différence de la Corée voilà trente ans, investit peu en R&D et toutes les technologies sont importées. En attendant, elle a fabriqué l’an passé 2,48 millions de véhicules, 10 % de plus que la France ! "Faire du business ici, c’est simple", assène Segsarn Trai-Ukos, le patron de Michelin en Thaïlande qui tente de participer au festin avec des groupes français tels que Saint-Gobain ou Faurecia.
L’Europe et la France dans tout cela ? L’Italien Antonio Tajani, commissaire européen chargé de l’industrie, ne s’avoue pas vaincu. "Nous avons un objectif volontariste : parvenir en Europe à 20 % du PIB dans l’industrie en 2020, contre 17 % aujourd’hui. C’est possible en jouant de nos atouts technologiques. L’un des remèdes à la désindustrialisation, c’est aussi l’internationalisation." L’OCDE ne dit pas autre chose. Elle a lancé en 2012 avec l’OMC une base de données sur les "chaînes de valeur mondiale". Pour Dorothée Rouzet, trade policy analyst à l’OCDE, "on voit que la compétitivité des exportations d’un pays dépend pour partie de leur contenu en importation de biens et services intermédiaires". Max Blanchet confirme. "Le sujet est 'qu’est-ce que je produis et où ?' Localiser des produits à valeur ajoutée comme du tissage de composite en 3D dans un pays à coût élevé n’est pas un problème. Mais il ne faut pas songer à conserver des activités non viables comme on le voudrait en France." Un choix fait il y a vingt ans par l’Allemagne avec son hinterland de sous-traitants en Europe de l’Est. Que certains imaginent pour la France avec le sud de l’Europe (Portugal…) ou de la Méditerranée.
Au Maroc, Abdelkader Amara, le ministre de l’Énergie, est familier du concept de colocalisation (repris par François Hollande lors de sa visite à Rabat, en avril). "Le Maroc peut être cette base de coût compétitive optimisant vos chaînes de valeur." Un choix fait par Aircelle (Safran), qui fabrique depuis quatre ans des composants de nacelles de réacteur à Casablanca, livrés en Normandie pour y être assemblés. "Sans cela, assure-t-on chez Aircelle, nous aurions perdu des marchés et de l’activité dans l’Hexagone." La bataille du made in France se gagne parfois par des voies détournées.
Pierre-Olivier Rouaud
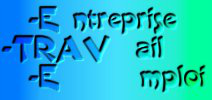 E-ENCYCLOPEDIE- -ETRAVE-
E-ENCYCLOPEDIE- -ETRAVE- 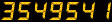 Visiteurs depuis fin 2012
Visiteurs depuis fin 2012






