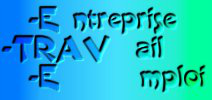 E-ENCYCLOPEDIE- -ETRAVE-
E-ENCYCLOPEDIE- -ETRAVE- 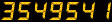 Visiteurs depuis fin 2012
Visiteurs depuis fin 2012
Copyright W4N1B4
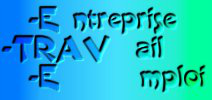 E-ENCYCLOPEDIE- -ETRAVE-
E-ENCYCLOPEDIE- -ETRAVE- 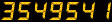 Visiteurs depuis fin 2012
Visiteurs depuis fin 2012

Voici un essai brillant qui, vingt ans après le fameux article de Denis Olivennes sur « la préférence française pour le chômage », fera date. A sa lecture, on ne peut s'empêcher de penser que l'objectif présidentiel d'inverser la courbe du chômage est incroyablement... peu ambitieux ! Le seul objectif valable devrait être le plein- emploi, or s'il semble hors d'atteinte aux yeux de la plupart de nos dirigeants politiques de droite comme de gauche, c'est d'abord parce qu'ils croient avoir « tout essayé », comme le prétendait jadis François Mitterrand. L'ouvrage de Bertrand Martinot, publié par l'Institut Montaigne, démontre avec brio qu'il n'en est rien.
La liste des pistes non explorées est impressionnante, comme si l'élite de ce pays s'était résignée depuis plus d'une génération à accepter un chômage de masse qui, même dans les meilleures périodes conjoncturelles, ne descend jamais en dessous de 8 %. Ce qui serait insupportable ailleurs est toléré ici avec un fatalisme doublé d'une dose de bonne conscience républicaine - les emplois aidés. Les quelque 50 milliards d'euros engloutis chaque année dans la lutte contre le chômage, comme le rappelle le président de l'Institut Montaigne Laurent Bigorgne dans sa préface, ajoutent sans doute à ce sentiment que, décidément, les pouvoirs publics font bien « le maximum ». « Le fatalisme s'est installé au plus haut niveau dans le paysage politique et social », écrit justement Bertrand Martinot. Venant de celui qui fut, en 2007-2008, conseiller social de Nicolas Sarkozy, les mots pèsent. « Le retour au plein-emploi, thème réapparu furtivement dans le débat public au début des années 2000, n'est plus un objectif politique. Il est considéré comme une utopie, voire comme une provocation. » Le contraste est fort avec Les Etats-Unis ou la Grande-Bretagne, où les banques centrales se sont fixé comme objectif de politique économique de ramener le taux de chômage sous la barre de 6,5 %. Fort également avec l'Allemagne, la Suède ou les Pays- Bas qui ont tous connus, ces dernières années, de longues périodes de quasi-plein-emploi. La France est-elle condamnée à ne jamais connaître une telle embellie ? Evidemment non. Mais il faudrait pour cela surmonter plusieurs blocages qui, depuis l'émergence du chômage de masse dans les années 1970, empêchent une amélioration durable et profonde de la situation de l'emploi.
Le premier blocage est lié au coût du travail qui, en France, à la différence des autres pays avancés, ne suit pas les évolutions de la productivité. « Le coût du travail au niveau du Smic a continué de progresser comme si la productivité avait suivi la tendance des années de forte croissance », relève Bertrand Martinot. Et ce, en dépit des allègements de charges sociales puisque ces derniers ont surtout pour objet de compenser le passage aux 35 heures. Le Smic est devenu « une machine à exclure », notamment les jeunes. « Il constitue pour eux une barrière à l'entrée sur le marché du travail ». Plus largement, la taxation du travail en France joue au détriment de l'emploi.« Le travail est surtaxé dans l'absolu, surtaxé en comparaison internationale, surtaxé car en décalage par rapport à la voie empruntée par la quasi-totalité de nos voisins depuis une dizaine d'années », déplore Bertrand Martinot. Au sein de l'OCDE, seule la Belgique taxe un peu plus le travail que la France. Le résultat est que, chez nous, « le travail est devenu un coût qu'il faut comprimer absolument, tandis qu'en Allemagne, il reste un capital humain qu'il faut préserver et entretenir ».
Un autre blocage français renvoie à la « faiblesse des relations sociales et au caractère foisonnant de la réglementation étatique et du droit du travail ». En conséquence, la justice joue, dans notre pays, un rôle qui n'a pas d'équivalent ailleurs : « Le juge remplit une partie de la mission de régulation qui échoit ailleurs au dialogue social. Cette substitution du juge à la négociation n'est une bonne nouvelle pour personne ». On a ainsi construit, à coup de textes nouveaux et de jurisprudence, « une ligne Maginot juridique qui, loin de protéger les salariés, se retourne contre ceux qui auraient le plus besoin de sécurité professionnelle ».
S'ajoutent enfin des blocages dus à « des conceptions obsolètes, voire dogmatiques de la politique de l'emploi ». L'auteur dénonce la politique des emplois aidés dans le secteur non marchand, peu efficaces et néanmoins employés à grande échelle par les gouvernements successifs pour obtenir un effet rapide mais largement artificiel sur les statistiques du chômage. Il pointe aussi les dysfonctionnements de Pôle emploi et les absurdités d'un système dans lequel l'Etat et les différents échelons administratifs interfèrent : « c'est dans la politique de l'emploi que le fameux millefeuille institutionnel français trouve son épanouissement le plus complet »... Derrière l'appellation « chômage structurel » se cachent de vrais blocages et un immense gâchis de ressources publiques et humaines. L'ouvrage fournit toutes les clefs pour y remédier.