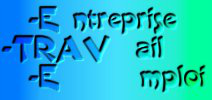 E-ENCYCLOPEDIE- -ETRAVE-
E-ENCYCLOPEDIE- -ETRAVE- 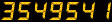 Visiteurs depuis fin 2012
Visiteurs depuis fin 2012
Copyright W4N1B4
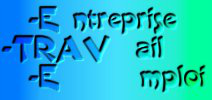 E-ENCYCLOPEDIE- -ETRAVE-
E-ENCYCLOPEDIE- -ETRAVE- 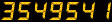 Visiteurs depuis fin 2012
Visiteurs depuis fin 2012
Le management de l’innovation propose de nombreux outils et méthodes permettant d’apporter instruments et réponses aux diverses interrogations qui peuvent se manifester avant, pendant et en post-période innovation. Ces véritables "batteries" se veulent rassurantes, car elles permettent de sécuriser les acteurs de l’innovation quant à ses aspects tant structurels qu’organisationnels. Pourtant, la question de la relation dans l’innovation apparaît tout aussi centrale. Combien de personnes impliquées dans des processus d’innovation se sont retrouvées au milieu du gué voire en situation d’échec alors que tous les outils techniques étaient présents ? Que manque-t-il alors ? Qu’est-ce que ne fonctionne pas ?
Au-delà des aspects managériaux "généralistes" que nous commençons à bien connaître, il apparaît que la relation manager-managé constitue un élément clé du management de l’innovation. Relations entre les acteurs, rapports hiérarchiques, dimensions et dynamiques collectives, la dimension humaine et relationnelle conditionnerait aussi largement le succès de l’innovation (*). Nous rentrons là dans la complexité du champ managérial. En prenant un peu de hauteur, on peut considérer que le management de l’innovation devrait porter son attention sur six dimensions à la fois sensibles, stratégiques et décisives :
• Un management du collectif : le collectif devrait être préféré à l’individualisme et aux individualités et nécessite un réel management : choix des personnes, postures communes, leadership adapté.
• Un management de la diversité : une réelle prise de conscience de l’existence puis du potentiel de cette diversité par les managers est essentielle. Elle devrait donc être intégrée au management et gérée comme une ressource afin de lui donner un sens et une finalité.
• Un management de l’auto-contrôle : le contrôle et l’évaluation devraient se situer dans l’auto-régulation par le groupe lui-même, le rôle du manager se situant davantage dans la reconnaissance et le soutien.
• Un management du relationnel et de la reconnaissance : l’innovation résulte avant tout de l’envie de chacun et de la capacité du manager à susciter l’envie. De plus, au-delà des récompenses monétaires, c’est la capacité de reconnaissance émotionnelle par la manager qui apparaît essentielle.
• Un management des situations organisationnelles : l’évolution et l’adaptation organisationnelles sont déterminantes pour l’innovation, la manager ayant un rôle essentiel dans cette "création" des conditions favorables à la prise de risques.
• Un management de l’information et du partage de la prise de décision : manager l’innovation, c’est avant tout informer et associer les managés aux processus décisionnels en faisant abstraction de la structure. La gestion du climat relationnel est essentielle alors que l’appui du manager sur une logique hiérarchique constituerait une entrave.
Ces six axes managériaux pourraient apparaître comme des "classiques". Et pourtant, disent les managés, c’est précisément autour de ces axes que tout se joue et que le management pêche le plus souvent. Domination des aspects techniques et des process sur les dimensions managériales et humaines, méconnaissance des conséquences de certains actes managériaux, absence de prise de recul et d‘esprit critique, les raisons sont multiples. Au final, les managés soulignent fortement le rôle du manager comme élément central de l’innovation, afin de créer "les conditions", de capter et gérer les émotions, d’être à l’écoute et de réguler.
(*) Barrand, Jérôme ; Sanséau, Pierre-Yves ; Ferrante, Guillaume, 2012. "The leader-member relationship at the core of innovation development : member perceptions, positions, expectations", dans Knowledge Perspectives of NPD : a comparative approach, édité par Assimakopoulos, Dimitris G. ; Carayannis, Elias G. ; Dossani, Rafiq, 141-158. New York : Springer.
Pierre-Yves Sanséau est Professeur à Grenoble École de Management