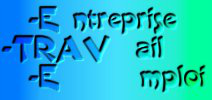 E-ENCYCLOPEDIE- -ETRAVE-
E-ENCYCLOPEDIE- -ETRAVE- 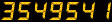 Visiteurs depuis fin 2012
Visiteurs depuis fin 2012
Copyright W4N1B4
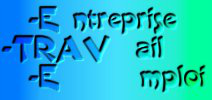 E-ENCYCLOPEDIE- -ETRAVE-
E-ENCYCLOPEDIE- -ETRAVE- 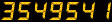 Visiteurs depuis fin 2012
Visiteurs depuis fin 2012

- Un défilé à Moscou en 2006. REUTERS/Sergei Karpukhin -
Imaginons six sextuplées de 23 ans dans une petite ville isolée des Etats-Unis. Comme l'endroit manque de jeunes célibataires disponibles, les jeunes femmes s'inscrivent sur un site de rencontre. Les photos qu'elles présentent sont presque identiques, sauf que chacune porte un tee-shirt d'une couleur unie différente. En ne prenant que ces portraits en compte, on aurait tendance à croire que ces six profils susciteraient le même intérêt... et on se tromperait lourdement.
Les hommes s'essayaient à l'art de la cour depuis des millénaires quand Gary Kremen jeta un pavé dans la mare avec la création, en janvier 1995, du premier site de rencontre en ligne, Match.com. Match a démocratisé le milieu de la séduction en donnant leur chance aux timides, nerveux et émotifs de tout poil dans une arène réservée jusqu'alors aux mâles alpha et aux Casanova de salon.
Loin du rythme effréné de la rencontre en face à face, les sites permettent de prendre tout son temps pour choisir des photos flatteuses, peaufiner sa présentation et confectionner de jolis messages. Mais si la donne est ainsi plus égale qu'autrefois, le jeu exige encore de maîtriser des règles tacites susceptibles de conférer l'avantage.
Selon Christian Rudder, créateur d'OkTrends, le blog (aujourd'hui inactif) d'observations tirées du site OkCupid, 32% des premiers messages postés donnent lieu à une réponse. En d'autres termes, deux messages d'origine sur trois se heurtent au silence.
Le taux de réponse dépend beaucoup du choix des mots. Ainsi, le langage SMS est largement condamné (le taux de réponse pour les messages qui comportent des «ur» [pour «You are»], «r» et autres «u» est inférieur à 10%), tandis que 50% des messages plus personnalisés, où l'on peut lire des «comme tu dis» ou «tu noteras que», entraînent une réponse.
De même, on réagit à l'évasif et impersonnel «salut» dans 23% des cas, alors que les interpellations directes telles que «Comment vas-tu?» enregistrent un taux de réponse de 53%. Si les personnes à l'origine de ces formules d'introduction se distinguent naturellement sur d'autres points, ces données montrent néanmoins que l'univers de la rencontre en ligne n'est pas exempt de petites manies.
Outre les messages soignés, il est un autre aspect essentiel parfois sous-estimé. Il y a quelques années, Andrew Elliot, professeur à l'université de Rochester, a ainsi mené une expérience avec sescollègues: il a demandé à des étudiants hétérosexuels de premier cycle de regarder pendant cinq secondes la photo d'une jeune femme inconnue, et de noter son attrait sur une échelle de 1 (pas du tout attirante) à 9 (extrêmement attirante). On a présenté aux jeunes hommes la même femme dans les mêmes vêtements, à ceci près que la couleur du large cadre de la photo était modifiée au hasard, entre blanc, rouge, bleu et vert.
Les psychologues savaient déjà que les couleurs ne sont pas anodines: le bleu est la teinte la plus populaire du monde, le noir évoque l'élégance, la richesse, le pouvoir et la force, le vert calme et apaise, et le rouge est la couleur de l'amour et du romantisme. Mais Elliot et son équipe voulaient ici tenter de découvrir si la couleur pouvait véritablement changer les attraits prêtés à une même personne.
Sur cinq expériences, les résultats ont été identiques: les étudiants qui avaient vu la photo au cadre rouge trouvaient la jeune femme plus attirante, et ils étaient plus enclins à l'inviter à sortir et à dépenser de l'argent pour elle.
Les chercheurs ont pris soin de démontrer que ces résultats étaient directement liés à l'attirance sexuelle; ils ont ainsi observé que, pour noter la même jeune femme, les étudiantes hétérosexuelles n'étaient pas influencées par le cadre de la photo. Enfin, les jeunes hommes n'estimaient pas que la femme au cadre rouge semblait plus aimable, gentille ou intelligente –simplement qu'elle était plus attirante et désirable.
Nicolas Gueguen, psychologue à l'université de Bretagne-Sud, a voulumener l'enquête sur le terrain, afin de vérifier si les résultats en laboratoire pouvaient être transposés dans la vraie vie. Pour ce faire, le chercheur a engagé cinq brunes âgées de 19 ans à 22 ans pour jouer les auto-stoppeuses. Les jeunes femmes portaient un jean, des tennis et un tee-shirt uni près du corps, comme nos sextuplées imaginaires. Aux beaux jours du début de l'été, chacune s'est tenue à tour de rôle, le pouce levé, au bord d'une route proche d'un lieu renommée de Bretagne. Au bout de 80 voitures, chaque jeune femme allait changer de tee-shirt, revêtant au hasard du noir, du blanc, du rouge, du jaune, du bleu ou du vert. (Deux personnes surveillaient de loin qu'elles ne craignaient rien.)
Plusieurs jours et 4.800 véhicules plus tard, Gueguen est retourné dans son laboratoire. Tout comme dans l'expérience d'Elliot, les conductrices n'ont pas été influencées par la couleur du tee-shirt des auto-stoppeuses –elles se sont arrêtées aussi bien quand les jeunes femmes portaient du rouge qu'une autre couleur. En regard, les conducteurs se sont montrés plus sélectifs: ils se sont arrêtés entre 12% et 15% des fois, sauf devant le tee-shirt rouge, pour lequel le taux d'arrêt a atteint 21%. Comme dans le laboratoire d'Elliot, les hommes ont donc montré une nette préférence pour les femmes en rouge.
Deux ans plus tard, Gueguen et sa collègue, Céline Jacob, ont renouvelé l'expérience sur un site de rencontre. Pendant neuf mois, 64 candidates se sont prêtées à l'expérience en acceptant de poster leur photo.
A l'aide d'un logiciel de retouche, Gueguen et Jacob ont créé six photos pour chaque femme, toutes semblables à l'exception de la couleur de leur tee-shirt. Toutes les deux semaines, les chercheurs changeaient de photo sur le site de rencontre et demandaient aux femmes de recenser le nombre d'hommes qui les avaient contactées.
Tout comme nos sextuplées virtuelles, six femmes identiques (à part la couleur de leur tee-shirt) convoitaient l'attention de milliers de soupirants. Et tout comme les auto-stoppeuses, ces femmes ont reçu bien plus de messages vêtues d'un tee-shirt rouge. Avec cette parure, 21% de leurs messages ont fait mouche, contre 14% à 17% dans l'ensemble avec les autres couleurs (noir, blanc, jaune, vert ou bleu).
Pourquoi le rouge écrase-t-il toutes les autres couleurs dans le jeu de l'amour et de la séduction?
Deux hypothèses au moins, dont l'une est plus convaincante. Commençons par celle qui l'est moins: nous serions conditionnés àassocier le rouge à l'amour, à la passion et au romantisme. Le rouge est la couleur du cœur, de la rose, du rouge à lèvres et du fard à joues, des quartiers chauds et des femmes fatales, et de la lettre «A» que Hester Prynne doit porter sur la poitrine en signe de son adultère dans La Lettre écarlate de Nathaniel Hawthorne.
Mais d'où vient cette association? Pourquoi le jaune, le noir, le bleu ou le vert ne sont-ils pas associés à l'amour? En réalité, et c'est l'hypothèse la plus probable, l'origine première de la charge romantique du rouge est que tous les animaux, du babouin au pinson en passant par l'homme, rougissent quand ils sont réceptifs sur le plan sexuel. La peau des femmes a tendance à rosir à l'approche de l'ovulation, puis s'éclaircit au cours de la période infertile du cycle menstruel. L'afflux sanguin conséquent au flirt fait rougir le visage, le cou et la partie supérieure de la poitrine, ce qui renforce le lien établi entre la teinte rouge et l'état de réceptivité sexuelle.
Et bonne nouvelle pour ces messieurs: les vêtements rouges les rendent eux aussi plus attrayants (les hommes rougissent également quand ils sont excités). Partout dans le monde, que ce soit aux Etats-Unis, en Chine ou en Allemagne, on retrouve cette même préférence pour les habits rouges. Dans la mesure où le phénomène ne se limite pas à une culture ou à une espèce, et où il disparaît quand les femmes sont ménopausées (c'est-à-dire quand elles ne sont plus fertiles), on peut en conclure que ce sont les aspects biologiques qui sont ici, au moins en partie, en jeu.
Et les couleurs ont leur importance dans d'autres domaines. A la fin des années 1980, par exemple, Mark Frank et Tom Gilovich ont procédé à l'analyse des statistiques de pénaltys de 21 équipes de la National Hockey League et de 28 équipes de la Nationale Football League. Dans chaque ligue, cinq équipes possédaient une tenue essentiellement noire, couleur associée à la méchanceté et l'agression, et les chercheurs ont découvert que ces équipes concédaient davantage de pénaltys que les équipes aux tenues plus claires.
De même, à la fin des années 1970, quand les Pittsburgh Penguins et les Vancouver Canucks ont adopté une tenue de hockey noire, ils ont presque immédiatement concédé plus de pénaltys. Frank et Gilovich ont par ailleurs montré que les étudiants étaient plus agressifs quand ils portaient un uniforme noir, et que cela avait même un effet néfaste sur les autres étudiants.
A l'autre extrémité du spectre, les chercheurs ont découvert dans les années 1970 un rose vif aux vertus apaisantes.
Gene Baker et Ron Miller, officiers de marine en poste à la prison militaire de Seattle, avaient constaté que les détenus agressifs étaient toujours aussi violents une fois passés par la cellule d'isolement. C'est alors que le psychologue Alex Schauss proposa une solution inédite. A la suite d'une série d'expériences, Schauss avait découvert que des jeunes hommes sains se trouvaient plus faibles après avoir regardé fixement une affiche d'un rose bubblegum.
Baker et Miller décidèrent d'essayer et firent peindre en rose vifl'intérieur de l'une des cellules de la prison. La légende raconte que les détenus qui y entraient en colère en ressortaient un quart d'heure après apaisés et détendus. Dans cet établissement pénitentiaire familier des éclats d'agressivité, pas un seul prisonnier retenu dans la cellule rose ne se montrait violent au cours des neuf mois suivants.
L'idée fit quelques émules: les entraîneurs de foot des universités du Colorado et de l'Iowa entreprirent de peindre de ce même rose les vestiaires de leurs visiteurs, dans l'espoir d'affaiblir leurs adversaires. Les associations sportives mirent bientôt le holà, en ayant l'intelligence d'exiger que les vestiaires de l'équipe à domicile et des visiteurs soient identiques.
Devenue célèbre, cette teinte appelée rose Baker-Miller ou encore «rose de dégrisement» (Drunk Tank Pink) connaît bien certains détracteurs quant à ses effets, mais Schauss et ses partisans maintiennent que ceux-ci sont bien réels.
Le noir, le rouge et le rose peuvent grandement influencer les pensées, les émotions et les comportements, dans des contextes que l'on n'aurait jamais soupçonnés. Il semble incroyable qu'une même personne puisse être plus heureuse en amour parce qu'elle porte un tee-shirt rouge, qu'un même footballeur puisse devenir plus agressif quand il enfile une tenue noire, et qu'un même colosse voie ses forces s'amenuiser en face d'une peinture rose –pourtant tout cela a bel et bien été constaté par l'expérience.
Bien sûr, les couleurs ne sont pas les seuls éléments périphériques qui modulent les pensées et les comportements. Mais ce que montrent ces exemples, c'est qu'une immense part de notre vie mentale évolue, comme la pointe de l'iceberg, sous la surface de la conscience. De quoi méditer avant de plonger dans les eaux surpeuplées des sites de rencontre...
Adam Alter