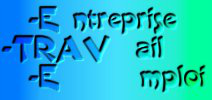 E-ENCYCLOPEDIE- -ETRAVE-
E-ENCYCLOPEDIE- -ETRAVE- 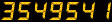 Visiteurs depuis fin 2012
Visiteurs depuis fin 2012
Copyright W4N1B4
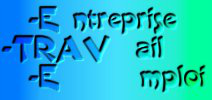 E-ENCYCLOPEDIE- -ETRAVE-
E-ENCYCLOPEDIE- -ETRAVE- 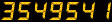 Visiteurs depuis fin 2012
Visiteurs depuis fin 2012

La Cour de cassation condamne les pratiques d’évaluation venues des Etats unis qui, fondées sur le classement des salariés par groupes de performances, imposent des quotas pour chacun de ces groupes.
Evaluer le travail des salariés est un droit que l’employeur tient de son pouvoir de direction. C’est même une nécessité pour les DRH. Les résultats d’une évaluation adaptée sont en effet un précieux outil de gestion des carrières.
L’entretien individuel, souvent annuel, entre le salarié et son supérieur hiérarchique, est la méthode d’évaluation la plus courante. C’est l’occasion de faire un point régulier sur l’atteinte des objectifs, les attentes de chacun et de fixer les objectifs de l’année à venir.
Certaines entreprises, appartenant en particulier à des groupes internationaux, ont adopté une méthode d’évaluation des salariés aboutissant à leur classement par niveau de performance. Elles se sont inspirées d’une pratique de management venue des Etats-Unis et appelée « forced ranking ».
L’exemple type de cette méthode est le modèle développé dans les années 1980 par le groupe General Electric : chaque directeur devait classer tous les ans ses employés dans 3 groupes en fonctions de quotas prédéfinis :
► 20 % dans le groupe des meilleurs qu’il fallait promouvoir ;
► 70 % dans le groupe intermédiaire satisfaisant et indispensable ;
► 10 % dans le groupe des moins bons qui seraient licenciés.
Les arguments en faveur de cette méthode sont lalutte contre l’inertie liée à la bureaucratie et lamotivation des salariés à devenir les meilleurs. Pas étonnant, donc, que des méthodes d’évaluation inspirées de ce modèle aient essaimé en France et que certaines aient fini par être contestées en justice.
Dans une décision rendue le 27 mars 2013, la Cour de cassation affirme l’illicéité d’un mode d’évaluation reposant sur la création de groupes affectés dequotas préétablis que les évaluateurs sont tenus de respecter.
L’affaire concernait un dispositif d’évaluation instauré chez Hewlett Packard France. Il était reproché à l’entreprise d’imposer un classement des salariés en 5 groupes de performances, selon des proportions fixées à l’avance : le groupe le plus faible devait comporter au moins 5 % de salariés, le groupe le plus performant au maximum 20 %.
Pour les juges, l’existence de quotas impératifs n’est pas admissible, car elle peut conduire l’évaluateur à classer dans le groupe des moins bons des salariés qui auraient mérité une meilleure appréciation si seule l’analyse de leur travail avait été prise en compte. Or, l’évaluation professionnelle des salariés doit être fondée sur des méthodes et des critères objectifs et pertinents.
En réalité dans cette affaire, un classement par quotas avait été préconisé par un membre de l’encadrement mais n’avait pas été retenu dans l’entreprise. Seules des propositions de fourchettes de répartition avaient été communiquées à titre indicatif aux chefs de services. Il n’existait donc pas de pourcentage fixe, ce qui excluait toute application d’une évaluation fondée sur le « ranking » par quotas. Au vu de ces éléments, les juges n’ont pas condamné le dispositif en cause.
Serait donc valable un système de classement des salariés par catégories sur la base de fourchettes de répartition non contraignantes pour l’évaluateur.
Néanmoins, la frontière entre une proposition non contraignante et une consigne impérative peut êtredifficile à tracer, en fonction des pressions informelles pouvant peser sur le personnel d’encadrement ou du zèle dont certains pourraient faire preuve pour plaire à leur hiérarchie… et être bien classés.
En tout état de cause, un dispositif d’évaluation doit être manié avec précaution. Selon ses modalités, il peut générer des risques psychosociaux, notamment s’il crée uneconcurrence entre les salariés. Or, l'employeur doit protéger la santé et la sécurité de son personnel en vertu de son obligation de sécurité.
Par exemple, le tribunal de grande instance de Lyon a interdit la mise en œuvre dans une entreprise d’un mode d'organisation du travail appelé « benchmark » et fondé sur une comparaison permanente des performances de chaque agence commerciale et de chaque salarié. En effet, un tel système mettait en danger la santé des salariés car il instaurait une concurrence entre eux, créait un stress permanent et dégradait lesrelations sociales dans l'entreprise.
Il ne faut pas non plus oublier que les résultats de l’évaluation professionnelle sontconfidentiels. Seuls le salarié et la hiérarchie y ont accès. L’employeur ne peut donc pas publier dans l’entreprise le classement obtenu, sous forme de palmarès par exemple, ni s’en servir comme instrument d’émulation entre les salariés. Il va de soi que la désignation de « derniers de la classe » est à proscrire.
Fondé sur des critères objectifs et pertinents, un système d’évaluation professionnelle fournit à l’employeur des éléments concrets sur lesquels il peut se baser pour prendre de nombreuses décisions à l’égard des salariés : promotions, augmentationsindividuelles de salaire (ou refus d’augmentation), formation professionnelle, etc. Ainsi, les données de l’évaluation peuvent justifier des différences de traitement entre les salariés, au cas où l’un d’eux s’estimerait victime d’une inégalité.
Par ailleurs, les mauvais résultats d’une évaluation permettent d’étayer, parmi d’autres éléments, une insuffisance professionnelle du salarié pouvant le cas échéant justifier un licenciement