TRIBUNE Dans sa nouvelle chronique, Alain Cadix expose les avantages d'un rapprochement entre les fonctions "recherche" et "design" dans les entreprises. Chargé de la Mission Design par les ministres du Redressement productif et de la Culture, l’ancien directeur de l'École nationale supérieure de création industrielle expose chaque semaine pour L'Usine Nouvelle sa vision des mutations de l'industrie par le prisme du design et de l'innovation.
Au moment où l’on observe sur des pans de l'économie une certaine inadaptation aux marchés mondiaux de l’offre de nos entreprises, en particulier des PME, les dispositions de politique économique tournées vers le renouvellement de l'offre devraient contribuer à rétablir les marges pour pouvoir investir, d'une part, et à réduire les incertitudes perçues par les entrepreneurs, d'autre part. Pour autant, une voie centrale se situe ailleurs, au cœur même des entreprises.
On touche ici à la notion de "propension à innover". Elle est fonction de variables qui sont d'abord liées au dessein, à la culture et au climat dans l'entreprise, à la confiance que ses collaborateurs mettent dans sa politique et en ceux qui l'incarnent. Mais elle est aussi tributaire d'options organisationnelles, ou plutôt inter-fonctionnelles, c'est à dire dépendant du choix des rouages mis en place.
RAPPROCHER LA R&D ET LE DESIGN
On a longtemps mis l’accent sur le couplage "ingénierie - marketing" pour augmenter l’aptitude de l’entreprise à innover avec succès. Dans les entreprises ayant un service de R&D et celles reliées à des laboratoires, c'est l'interaction "recherche – marketing" ou "recherche – marketing – ingénierie" qui est le plus souvent mise en avant. Dans tous les cas le marketing y joue un rôle central. Le design, quant à lui, s'il est sollicité, est placé à la périphérie, rattaché au marketing et réduit au style. Les résultats sont assez déceptifs globalement : soit parce que l’on n’a pas vu arriver les ruptures, soit parce que, emporté par le flux dominant, l’on a contribué à la sur- et à la mal-consommation.
On se rend compte enfin que la fonction marketing ne peut pas être – sauf cas exceptionnels – une force de proposition pour des innovations radicales : celles qui créent un nouvel univers, un nouvel imaginaire, de nouvelles façons de faire et de penser ; celles aussi qui confèrent un monopole induit profitable, qui démarquent l’entreprise, valablement et durablement, de ses compétiteurs. Le marché ayant peu d’imagination pour la rupture, la fonction qui en fait sa raison d'être et y puise son inspiration est frappée de la même déficience. Une remarque toutefois : si le marché, pris comme tel, n’est pas imaginatif, il existe dans la société des niches, des tiers-lieux de créativité que le sociologue ou l’anthropologue, mieux que le marketer, peut décrypter.
La voie empruntée par les entreprises les plus innovantes sur la scène internationale est celle d’un rapprochement entre R&D et design, entre chercheurs (intégrés ou non), ingénieurs de conception et designers (intégrés ou non) pour inventer des concepts d’objets (produits, services, systèmes, etc.) et leur donner forme ; le marketing n’étant pas hors champ, mais dans un second cercle, dans une situation d’interaction avec les marchés pour exprimer le moment venu des conditions de recevabilité des objets conçus.
Le design dépasse ici la forme qui leur est donnée. Tel qu’il est entendu dans ces firmes, il exprime avec un regard différent, créatif, la relation de l’entreprise aux hommes. Il change le filtre au travers duquel la société et les individus sont observés et appréhendés. Il reconsidère la fonction attendue d’un objet par le biais d’un regard diagonal, original. Celui qui peut ouvrir des voies de traverse insoupçonnées, et donc encore vierges, vers la proposition de nouvelles expériences. Il imagine aussi de nouveaux modèles d’organisation sociale. Au-delà de l’évolution des formes, des novations fonctionnelles, c’est vers un changement de règles du jeu qu’il engage l’entreprise. C’est un risque à prendre dans le contexte actuel.
RAPPROCHER CHERCHEURS ET DESIGNERS AUSSI DANS LA SPHÈRE PUBLIQUE
C’est là que se justifie et s’exprime plus particulièrement le dialogue, la "conversation" entre designers et chercheurs. Ces derniers, qui ne sont pas nécessairement des collaborateurs de l’entreprise concernée (ils peuvent être dans des laboratoires partenaires) œuvrent dans le champ des sciences dites dures, physique, mécanique, sciences des matériaux, etc., mais aussi dans celui des sciences dites molles ou douces, pour reprendre le mot de Michel Serres, anthropologie, micro-économie, sociologie, etc.
Chercheurs et designers sont potentiellement des projeteurs et des explorateurs. Ils doivent être attentifs aux tiers-lieux innovants disséminés dans la société. Les uns et les autres reformulent souvent de façon très ouverte, originale, les questions qui se posent au monde. Cela peut déranger et pourtant c’est par là que passent de véritables innovations. C’est ce qui a manqué ces dernières décennies à notre économie – par ailleurs entravée par des règlementations et des rigidités nationales.
Mais le rapprochement entre chercheurs et designers, plus largement créateurs, ne doit pas être prôné uniquement dans la sphère privée. Il doit aussi s’opérer dans la sphère publique. Les centres de transfert des laboratoires et les SATT (société d’accélération du transfert de technologie) doivent s’attacher les services de designers, sans pour autant abandonner ceux de marketers dont ils s’entourent exclusivement aujourd’hui. Le CEA à Grenoble s’y est mis, ainsi que la SATT Lutech à Paris, tous deux avec l’ENSCI – Les Ateliers.
Il serait profitable que les autres SATT, mais aussi l’INSERM, l’INRIA, l’INRA, le CNRS, entrainant avec eux nos universités par le biais des unités mixtes de recherche, s’y engagent avec d’autres écoles et des agences de design, notamment pour imaginer le futur d’une découverte ou d’une invention, ses applications possibles, parfois hors du champ auquel elle était destinée a priori.
Alain Cadix, chargé de la Mission Design auprès des ministères du Redressement productif et de la Culture
@AlainCadix
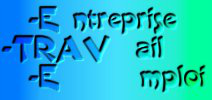 E-ENCYCLOPEDIE- -ETRAVE-
E-ENCYCLOPEDIE- -ETRAVE- 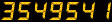 Visiteurs depuis fin 2012
Visiteurs depuis fin 2012





