Helle Thorning-Schmidt s’en était doutée. Qu’elle, Premier ministre danoise sociale-démocrate, approuve la vente de 26% du principal groupe énergétique public à des investisseurs privés ne manquerait pas de faire des mécontents. Mais elle ne s’attendait pas à un tel tollé. Pétition en ligne signée par 200.000 Danois (sur 5,6 millions), manifestation devant le Parlement, départ fracassant de six ministres de son gouvernement…
C’est que le principal acquéreur des actions de Dong Energy (19%) ne paraît pas des plus fréquentables aux yeux de certains : il s’agit de la banque d’investissement américaine Goldman Sachs, dont le nom est associé à la crise des subprimes et à un certain capitalisme sans scrupule. Peu compatible a priori avec la tradition de dialogue social cultivée au pays de la petite sirène d’Andersen. D’après un sondage, 68% des Danois sont opposés à la vente.
Malgré cela et malgré la démission des ministres d’un parti de gauche, le 30 janvier, Helle Thorning-Schmidt a décidé d’aller de l’avant. Selon elle, Dong Energy, l’équivalent à l’échelle danoise de ce que fut un temps EDG-GDF en France, a grand besoin d’argent frais pour continuer à se développer. Pour faire passer au Parlement la vente à Goldman Sachs, la Premier ministre peut compter sur l’appui du centre et de la droite. Un soutien qui risque de renforcer à gauche son image de dirigeante prête à tous les compromis pour mener sa politique. Pour d’autres, au contraire, elle fait preuve de pragmatisme, et tente d’adapter le pays face à la concurrence mondiale.
Dialogue social préservé
Hausse de l’âge du départ à la retraite, réduction des allocations chômage, de l’impôt sur les sociétés et des charges patronales : le Danemark de "Gucci Helle" – sobriquet attribué en raison de ses tenues chics –, ressemble de plus en plus à… la Suède du conservateur Fredrik Reinfeldt. Lui aussi, depuis son accession au pouvoir en 2006, rend de plus en plus caduque la représentation qu’on se fait souvent de ce pays, en France et ailleurs.
Le fameux "modèle" suédois, mais aussi scandinave, n’est sans doute pas mort, mais il n’a plus grand-chose en commun avec ce qu’il était dans les années 1960-1970, lorsqu’on se mit à l’étudier sous toutes ses coutures. Le dialogue social est encore là, avec le système de conventions collectives. L’éducation reste gratuite jusqu’à la sortie du lycée. La parité fait l’objet d’une politique volontariste. Mais c’en est fini de l’Etat providence fort, prenant les citoyens en main jusqu’à la mort moyennant les impôts les plus lourds du monde.
La pression fiscale a baissé, les dépenses publiques et les avantages sociaux aussi. L’Etat s’est désengagé des secteurs des télécoms, de l’énergie, de la banque, de l’assurance…
Et ce n’est pas terminé : en Norvège, un nouveau gouvernement de droite a pour ambition de vendre d’autres actifs, notamment dans la compagnie Statoil. En Finlande, un débat a également lieu sur la question des privatisations, au sein d’un gouvernement alliant conservateurs et sociaux-démocrates.
Boom de l’école privée
Décision ayant encore plus d’impact dans la vie des Nordiques, les Etats ont ouvert certains services au privé. La tendance est le plus marqué en Suède. Le monopole public dans les transports, les télécoms, la poste et les pharmacies n’est plus qu’un souvenir. Le gouvernement Reinfeldt a introduit le privé dans les secteurs des soins et de la santé, et l’a dopé dans l’éducation. Ainsi, dans le primaire, 13% des enfants fréquentent-ils des établissements privés, 19% dans le secondaire, avec une pointe de 50% à Stockholm. "Les parents ne paient rien, comme dans le public : ce sont les communes qui financent", précise Claes Nyberg, le président de la Fédération des écoles libres. Les contribuables, donc.
Cette évolution n’est pas toujours du goût des populations. Au Danemark, la popularité du gouvernement en a pris un coup depuis l’affaire Goldman Sachs. Et à sept mois des législatives suédoises, la coalition au pouvoir est donnée largement perdante dans les sondages. Si les raisons sont multiples, les scandales portant sur des abus ou des négligences de sociétés privées gérant des hôpitaux et des maisons de retraite ne sont pas étrangers à l’affaire.
Antoine Jacob (à Stockholm)
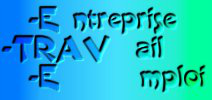 E-ENCYCLOPEDIE- -ETRAVE-
E-ENCYCLOPEDIE- -ETRAVE- 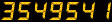 Visiteurs depuis fin 2012
Visiteurs depuis fin 2012





