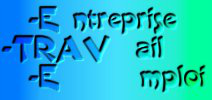 E-ENCYCLOPEDIE- -ETRAVE-
E-ENCYCLOPEDIE- -ETRAVE- 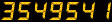 Visiteurs depuis fin 2012
Visiteurs depuis fin 2012
Copyright W4N1B4
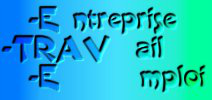 E-ENCYCLOPEDIE- -ETRAVE-
E-ENCYCLOPEDIE- -ETRAVE- 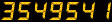 Visiteurs depuis fin 2012
Visiteurs depuis fin 2012

- REUTERS/Phil Noble -
Cinq ans après le début de la crise financière, la reprise économique est là, elle se confirme mondialement, mais son ampleur déçoit. Les pays émergents sont chacun entrés dans des problèmes internes lourds. La croissance américaine est grosso modo divisée par deux par rapport à l'avant-crise. Et en Europe, les observateurs parlent de fragilité, d'hésitations et de possible rechute. Pourquoi cette mollesse?
On peut accuser les banques centrales de n'être pas encore assez «accommodantes» pour faciliter le crédit, ou de l'être trop. On peut débattre à l'infini pour savoir si les gouvernements, en particulier en Europe, appliquent trop d'austérité ou pas assez. Tout cela est sans doute intéressant mais, sur le fond, secondaire.
La cause principale de la faible croissance est... le manque d'effet positif des technologies. Affirmation difficile à croire à première vue. Les smartphones, les robots, les biotechnologies, les nouvelles énergies… autant de belles machines qui ont «changé nos vies».
On pensait qu'elles amélioraient grandement la vitesse et la qualité de notre travail. C'est faux. Ces technologies se répandent à profusion, mais, dans les pays développés, la productivité stagne. Elles sont de ce point de vue inutiles.
Quand on observe sur le long terme les statistiques, on note une lente baisse des gains de productivité de 1946 à 1980, un très léger regain ensuite puis, une nette chute à partir de 2000[1]. Dans cette optique, la croissance d'avant-crise n'avait été forte aux Etats-Unis que du fait de l'accroissement de la population (merci l'immigration) et de la bulle des emprunts rendus peu onéreux par la politique de la Réserve fédérale.
Cette croissance n'était en somme qu'artificielle. Une fois la bulle explosée par la crise, l'Amérique retombe aujourd'hui sur un rythme naturellement faible de productivité et de croissance. Et l'Europe, qui suit depuis la guerre cette économie leader, ne sait pas faire mieux.
Ce paradoxe de la high-tech inutile avait été mis en avant par Robert Gordon, professeur à la Northwestern University dans les années 1990. La petite remontée des gains de productivité avant 2000 lui avait donné tort. Mais aujourd'hui sa thèse redevient centrale.
Gilbert Cette, directeur des études à la Banque de France, la confirme en ajoutant que l'épuisement des gains de productivité est plus net encore en Europe. L'explication serait à chercher, selon lui, dans les performances des puces (les semi-conducteurs), dont les améliorations seraient devenues moins rapides tandis que les coûts de recherche-développement auraient explosé. Il estime que nous sommes arrivés sur un plateau mais que les progrès repartiront, comme avant, dans trois ou cinq ans.
D'ici là, faute de gain de productivité, allons-nous subir une croissance imparablement molle? N'y a-t-il rien à faire? En particulier en Europe et en France? On peut le penser. Après tout «ces choses-là nous dépassent», la France n'a su inventer ni le microprocesseur ni l'iPhone, encore moins les OGM. Elle a perdu pied dans l'industrie high-tech au cours des décennies précédentes et elle est en train de perdre son dernier pion, les télécoms, sans que le gouvernement s'en émeuve autrement que par des bla-bla-bla.
Pour Gilbert Cette, l'horizon n'est pas bouché. Que la productivité américaine soit sur un plateau n'empêche pas de la rattraper, bien au contraire.
Tout l'objectif d'un gouvernement devrait être de déjouer le paradoxe de Gordon en faisant tout pour favoriser ces gains de productivité. Qu'est-ce à dire? D'abord de virer de bord et de ne plus défendre les vieux emplois des entreprises dépassées.
La productivité doit être réhabilitée: elle est à promouvoir et non pas à combattre. Ensuite de se donner pour devoir de faire repartir l'investissement. La liste de ce qu'il faudrait faire a été détaillée dans lerapport Gallois: «choc de compétitivité», simplification, formation… Enfin, se doter d'une stratégie industrielle entièrement repensée.
L'industrie est à la base des gains de productivité. Elle n'est pas la seule: dans la santé par exemple, Muhammad Yunus (l'inventeur du microcrédit) a démontré, en Inde comme à New York, qu'on pouvait soigner mieux en dépensant beaucoup moins d'argent.
Mais soit, l'industrie reste un vecteur essentiel de l'innovation. Comment? En France, le gouvernement a arrêté 34 secteurs qu'il considère comme «stratégiques». Cette politique fait plaisir aux étatistes mais, outre qu'elle a souvent échoué par le passé, les secteurs «stratégiques» sont-ils les meilleurs moteurs de la productivité donc de la croissance?
Analysant la politique britannique, deux économistes, Neil Lee et Andrès Rodriguez-Pose, montrent que «le lien entre les industries stratégiques et l'innovation est plus lâche qu'espéré». Les firmes aidées se contentent souvent de recopier, pas d'inventer.
Ils avancent que l'innovation véritable vient moins souvent de l'Etat que des villes et des lieux où les gens se croisent et changent de job. La France devrait en tirer la conclusion qu'il vaut mieux aider les «métiers créateurs» que les industries stratégiques. Le progrès a changé, expliquent les auteurs, il se fait non linéaire, vient de petites ruptures, se nourrit des erreurs et de l'expérience des autres.
Une politique qui ne privilégie aucun secteur mais amplifie l'investissement, la créativité et l'innovation dans tous: agriculture, industrie et services. Voilà la seule manière de débloquer la croissance.
Eric Le Boucher
Article également publié dans Les Echos
[1] Productivité et croissance en Europe et aux Etats-Unis, La Découverte. Retourner à l'article