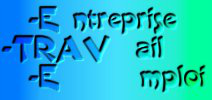 E-ENCYCLOPEDIE- -ETRAVE-
E-ENCYCLOPEDIE- -ETRAVE- 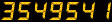 Visiteurs depuis fin 2012
Visiteurs depuis fin 2012
Copyright W4N1B4
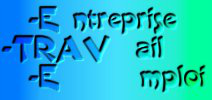 E-ENCYCLOPEDIE- -ETRAVE-
E-ENCYCLOPEDIE- -ETRAVE- 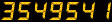 Visiteurs depuis fin 2012
Visiteurs depuis fin 2012

|
Martine Fournier
Mis à jour le 15/06/2011 À l’heure où les sociétés se mondialisent, où la recherche s’internationalise, qu’en est-il de l’ouverture des universités françaises au reste du monde ? La mobilité des jeunes enseignants chercheurs reste encore limitée. On trouve moins de 10 % d’étrangers dans les établissements supérieurs français ; parmi eux, 55 % sont européens, 23 % africains (issus des anciennes colonies françaises), le reste se partage entre Asiatiques et Américains. Les grandes écoles cependant font un peu mieux que l’université (12 % contre 7 %), ce différentiel s’expliquant par une plus grande souplesse dans les recrutements et des salaires plus attractifs. L’internationalisation du marché du travail universitaire, si elle demeure en France très en retrait des autres États de l’Europe du Nord et notamment de la Grande-Bretagne, est cependant en progrès notent Gaële Goastellec, chercheuse de l’université de Lausanne, et Catherine Paradeise, sociologue au CNRS. La mise en place de l’autonomie des universités et des différentes mesures récentes vont dans ce sens, ajoutent-elles, en permettant une diversification des emplois, des niveaux de salaires et une réactivité accrus de la part des établissements recruteurs. Dans le cadre de sa présidence à l’Union européenne (à partir de juillet 2008), le gouvernement français a en outre l’intention de saisir les ministres européens sur la question de la démocratisation de la mobilité étudiante : montant des bourses, meilleure reconnaissance des diplômes avec la mise en place d’un contrôle qualité.
Gaële Goastellec et Catherine Paradeise, « L’Enseignement, une réalité de plus en plus internationale ? », Cahiers Français, La Documentation française, n° 344, mai-juin 2008, et « La France prône l’amélioration de la mobilité étudiante en Europe », La Lettre de l’éducation,n° 600, juin 2008. |