TRIBUNE Alain Cadix, administrateur général du Programme Paris Nouveaux Mondes (Investissements d’avenir / Idex) du Pôle de recherche et d’enseignement supérieur HESAM, évoquent des pistes pour combler les faiblesses des pôles de compétitivité. Ce dispositif lancé en 2004 peine, selon lui, à faire ses preuves.
Un récent rapport des services de l’État a mis le doigt sur une certaine insuffisance créatrice – en termes d’innovations, d’entreprises, de croissance, d’emploi – de nos pôles de compétitivité. Les résultats sont jugés en deçà du potentiel. Rien d’étonnant. Les pôles vivent au rythme des appels à projets (FUI, ANR, ADEME, etc.) de l’État, parfois des Régions. Ces appels à projets ont des cahiers des charges. Pour l’essentiel ils sont orientés vers la recherche en amont, les avancées scientifiques et technologiques, très rarement vers les retombées. Le président d’un pôle me disait il y a peu : "95% de notre temps nous parlons de technologie et 5% nous parlons d’usages". Or chacun sait que la technologie est bien peu sans ses usages… Les cahiers des charges, première piste, peuvent faire bouger des lignes entre amont et aval.
LE POSITIONNEMENT AMONT, UN FREIN À LA CRÉATION DIRECTE D'ACTIVITÉ
Les pôles ont été conçus avec un positionnement amont par rapport aux marchés, dans ce qu’il est convenu d’appeler le précompétitif. Comment en effet financer du "D" plus que du "R" quand, dans le cercle des entreprises du "cluster", certaines sont en concurrence directe ? Ce positionnement amont est un frein à la création directe d’activité que porterait un positionnement plus aval. Il ne peut cependant tout expliquer à cet égard, et notamment pas le faible taux de création d’entreprises.
DÉFICIT DE CAPITAL-RISQUE
Il est un autre frein à la création qu’il faut aussi chercher dans la genèse des pôles. J’y avais pointé une faiblesse (Le Monde, 27 juillet 2005). Il n’existe pas de "cluster" dynamique ailleurs en Europe, aux Etats-Unis ou en Asie, sans une présence fournie et active du capital-risque. La circulaire du gouvernement de 2004, lançant le mouvement des pôles, ne mentionnait pas cette composante essentielle comme une condition d’éligibilité du cluster – jusque dans sa gouvernance ! Sa relative faiblesse en France n’était pas un obstacle de principe à sa présence dans ces cénacles de l’innovation. Elle aurait orienté plus fortement les activités des pôles vers la création d’activités, de start-up, de spin-off, etc. Il est peut-être encore temps de le corriger, deuxième piste, en faisant monter dans les dispositifs de gouvernance des institutions financières – du moins celles que la prise de risque n’inhibe pas trop –, des associations de Business Angels, etc... Il faudra aussi faire une place à la nouvelle Banque publique d’investissement dont il est beaucoup attendu.
L’autre obstacle à la création d’activité et d’emploi est la faible prise en compte des usages des technologies dans les activités des pôles de compétitivité. Qu’est-ce qu’un usage ? C’est la destination, la fonction de quelque chose, l’emploi que l’on peut en faire. C’est le fait même de s’en servir. Mais c’est par ailleurs une pratique observée dans un groupe social, une coutume.
ELARGIR LE CERCLE DES COMPÉTENCES
Quand on veut traiter de l’usage, ou des usages d’une technologie, il faut se placer aux deux niveaux sémantiques : celui de l’emploi direct et celui du contexte social et culturel qui pourrait l’accueillir. Et c’est là que le dispositif réticulaire actuel montre ses limites. Le cercle doit s’élargir au-delà des écoles de commerce et des cabinets d’études de marché, vers les centres de recherche en sciences humaines et sociales – du moins ceux qui font du transfert vers la société une des raisons essentielles de leurs travaux et de leur existence – et vers les écoles et agences de design, c’est dire vers la création. Je verrais bien dans ces pôles, troisième piste, des "Innovation Labs", où se mêleraient sociologues, anthropologues, ingénieurs, marketers, financiers, designers – ces derniers devraientnaturellement jouer un rôle de médiation et d’intégration – et philosophes aussi. Les uns et les autres étant étudiants, professionnels, ou enseignants-chercheurs, notamment pour les SHS. La présence de la philosophie, la science du questionnement, ferait écho à celle du design, quand il est, comme par exemple à l’ENSCI – Les Ateliers, l’art de fabriquer des questions et de construire des « architectures des possibles », ainsi que le dit le designer Jean-Louis Fréchin.
Tout cela serait à prendre en compte par la mission Beylat-Tambourin sur les systèmes de transfert et d’innovation, commanditée par les ministres Geneviève Fioraso et Fleur Pellerin.
Alain Cadix
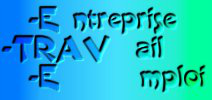 E-ENCYCLOPEDIE- -ETRAVE-
E-ENCYCLOPEDIE- -ETRAVE- 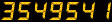 Visiteurs depuis fin 2012
Visiteurs depuis fin 2012




